-
 Hannah Arendt à Jérusalem. Au-delà de la question du mal,
Hannah Arendt à Jérusalem. Au-delà de la question du mal,
celle de la « grandeur du judiciaire ».
par Vincent Lefebve, chercheur au Centre de droit public. -
Puisque nous parlons de cinéma, et donc de la force de l’image, partons de l’affiche du film : on y voit Hannah Arendt (ici incarnée par Barbara Sukowa), devant sa machine à écrire, avec en toile de fond le tristement célèbre drapeau du Reich allemand de 1933 à 1945, c’est-à-dire la svastika noire, logée au sein d’un cercle blanc, lui-même cerné de rouge.

-
Il n’est pas inutile de préciser, d’emblée, les deux interprétations concurrentes qui peuvent surgir à l’esprit de celui qui observe un tel montage. L’interprétation la plus évidente est bien sûr celle-ci : Hannah Arendt est connue comme cette intellectuelle juive qui a tenté de comprendre le nazisme et, plus généralement, le phénomène du totalitarisme. La machine à écrire rappelle non seulement son activité de « reporter » et d’écrivain en lien avec le procès Eichmann, mais aussi l’inlassable effort qui fut le sien pour mettre en mots et en concepts les événements politiques tourmentés du XXe siècle.
-
Il ne faut cependant pas négliger une autre interprétation : si le drapeau national-socialiste flotte derrière Arendt, c’est parce que celle-ci se serait montrée « complaisante » avec l’accusé au centre du procès qu’elle fut amenée à couvrir, Adolf Eichmann, et plus généralement avec les agissements criminels des dirigeants et des personnages-clés au sein de la machine de guerre et de mort nazie.
-
Cette seconde interprétation pourrait paraître, au premier abord tout à fait absurde. Ainsi, Hannah Arendt, l’une des plus grandes philosophes du siècle dernier, une philosophe juive, ayant été confrontée en cette qualité de manière tout à fait directe à la violence nazie (à laquelle elle n’échappa qu’en fuyant l’Allemagne et ensuite la France occupée, dans laquelle elle avait trouvé refuge), ainsi cette géante de la pensée, l’une des premières à être parvenue à identifier les ressorts du totalitarisme afin de mieux le combattre, serait-elle subitement devenue « complaisante » avec Adolf Eichmann, l’un des principaux artisans de la shoah.
-
Cette voie, certains l’ont suivie, durant la féroce polémique qui a éclaté suite à la parution du compte-rendu du procès Eichmann proposé par Arendt. Dans le monde francophone, le sommet a été atteint lorsque Le Nouvel Observateur, dans son numéro du 26 octobre 1966, a décidé de titrer l’un de ses papiers : « Hannah Arendt est-elle nazie ? ». Plutôt qu’un article, il s’agissait, pour l’hebdomadaire français, de publier trois des nombreuses lettres reçues par la rédaction de ce magazine suite à la parution de certains extraits du livre d’Arendt.
-
Je ne m’intéresserai pas ici à la controverse en tant que telle, spécialement à son point de focalisation le plus sensible : la mise en cause par Hannah Arendt du rôle des « conseils juifs » dans le déroulement du processus d’extermination du peuple juif européen (en un mot, si l’on analyse les choses froidement et avec le recul historique qui est le nôtre, on peut dire que Hannah Arendt s’est, sur ce point précis, montrée quelque peu imprudente). Je voudrais seulement indiquer ici l’écart entre, d’une part, le rôle intellectuel d’Arendt dans la compréhension et la dénonciation du totalitarisme et, d’autre part, certains dérapages auxquels a conduit la polémique, une polémique qui a sans doute porté, dans une large mesure, sur un livre que personne n’a lu, comme Arendt elle-même l’indique souvent. Pour mesurer cet écart, il suffit peut-être de rappeler cette déclaration d’Arendt, à l’époque de la rédaction des Origines du totalitarisme : « mon premier problème fut de savoir comment écrire historiquement à propos de quelque chose – le totalitarisme – que je ne voulais pas conserver mais m’employais, au contraire, à détruire » (Hannah Arendt, « Une réponse à Eric Voegelin », in Les Origine du totalitarisme, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002, p. 968). « Hannah Arendt est-elle nazie ? » : cette question, tellement incongrue, tellement déplacée, a de quoi faire frémir.
-
 Une conséquence moins souvent aperçue de l’immense et violente controverse qui s’est déployée des deux côtés de l’Atlantique, et même au-delà, est qu’elle a conduit à masquer une dimension centrale de la réflexion d’Arendt : la justice. Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal nous parle en effet de justice et, malgré certaines ambiguïtés, il s’agit d’un livre qui traite non de l’impossibilité de la justice humaine, mais de sa possibilité même, et ce alors même que nous nous trouvons confrontés à des faits et à des crimes aussi extrêmes que révoltants, aussi inédits que déconcertants.
Une conséquence moins souvent aperçue de l’immense et violente controverse qui s’est déployée des deux côtés de l’Atlantique, et même au-delà, est qu’elle a conduit à masquer une dimension centrale de la réflexion d’Arendt : la justice. Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal nous parle en effet de justice et, malgré certaines ambiguïtés, il s’agit d’un livre qui traite non de l’impossibilité de la justice humaine, mais de sa possibilité même, et ce alors même que nous nous trouvons confrontés à des faits et à des crimes aussi extrêmes que révoltants, aussi inédits que déconcertants.
-
Le film de Margarethe von Trotta permet-il de mieux mettre en évidence cette dimension oubliée ou recouverte du livre d’Arendt ? À cette question, j’aurais tendance à répondre de manière plutôt affirmative. Le choix qui a été fait par la réalisatrice allemande de se concentrer sur une période déterminée de la vie de la philosophe impliquait que le procès Eichmann soit mis au centre de l’attention du spectateur, ce qui est à mon avis assez heureux. En d’autres termes, si nous avons affaire à un authentique film biographique, à un « biopic », celui-ci se concentre sur une période déterminée : le procès Eichmann et la lecture qu’en a proposé Arendt. Un tel choix n’avait rien d’évident. Margarethe von Trotta expliquait récemment dans une interview avoir tout d’abord envisagé de consacrer un long métrage à l’ensemble de la vie d’Arendt : auraient alors été traitées les grandes étapes de la riche biographie de la philosophe, de ce parcours existentiel et intellectuel remarquable, depuis les années de formation en Allemagne, auprès des plus grands philosophes de son temps (Husserl, Heidegger, Jaspers), jusqu’aux années « américaines », en passant par les années les plus sombres. Mais il a semblé opportun à la réalisatrice de resserrer la narration autour d’un événement précis et déterminant.
-
Le procès Eichmann ne sert pas uniquement de toile de fond à l’intrigue : il en est aussi rendu compte, de façon intelligente, au moyen d’images d’archives. Le mariage entre images de fiction et image d’archives se retrouve dans l’extrait que j’ai sélectionné, lequel met en outre en évidence un élément important du procès dont je vais immédiatement proposer un commentaire.

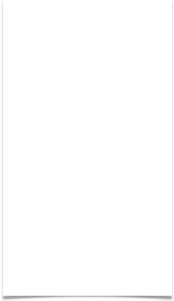





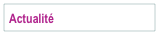

Appels à candidatures
-
Dans cet extrait, la réalisatrice insiste ainsi sur l’opposition d’Arendt à la vision ainsi qu’au « style » qui sont ceux de Gideon Hausner, procureur chargé de l’accusation lors du procès d’Adolf Eichmann devant le tribunal de Jérusalem. Le discours d’ouverture du procureur était certes destiné à émouvoir, et il a ému de nombreux observateurs ; Arendt n’y voit, quant à elle, que « rhétorique de pacotille » (Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002, ci-après « EJ », p. 1037). De manière plus générale, elle reproche au procureur, d’une part, de se focaliser sur les souffrances des Juifs et non sur les actes d’Eichmann et, d’autre part, de substituer à l’objectif authentique du procès, qui consiste à juger Eichmann, un objectif plus général : insérer la Shoah et la création de l’État d’Israël dans l’histoire millénaire de l’antisémitisme. Or, selon Arendt, et elle est inflexible sur ce point, le but d’un procès, aussi exceptionnel soit-il, n’est pas de faire de la politique ou de réécrire l’histoire, mais de rendre le droit. La tâche qui incombait au tribunal de Jérusalem était donc la suivante : peser les charges retenues contre l’accusé, écouter les arguments de l’accusation et de la défense, ainsi que les témoins, évaluer les documents produits par les parties, mener les débats et, finalement, rendre un verdict, verdict qui concerne une personne « en chair et en os » et non un système politique, une idée abstraite ou une tendance historique. Cela, nous dit Arendt, les juges de Jérusalem, au contraire du procureur, l’ont très bien compris.
-
Comme l’atteste le dialogue qui ponctue l’extrait que l’on vient de voir, dialogue que nouent Arendt et son vieil ami Kurt Blumenfeld (avec lequel elle finira par se brouiller), le procureur ne semble être qu’un pion sur un échiquier plus large, celui de la raison d’État. En tant que représentant du gouvernement israélien, Gideon Hausner « fait de son mieux, fait vraiment de son mieux, pour obéir à son maître », écrit Arendt dans Eichmann à Jérusalem (EJ, 1022). Ce « maître » n’est autre que David Ben Gourion, le Premier ministre israélien, qui n’est pas seulement « l’architecte de l’État », mais aussi « le metteur en scène invisible des débats » qui se déroulent à Jérusalem (EJ, 1022). « Invisible » parce qu’il n’assiste pas aux audiences, sinon par l’entremise du procureur. Le récit que souhaitait produire Ben Gourion – qu’on y adhère ou non – était celui d’un peuple, le peuple juif, un peuple persécuté, un peuple meurtri au point de frôler la destruction totale, et ce malgré sa résistance courageuse, dont l’insurrection du ghetto de Varsovie devait devenir le symbole, un peuple dont la résurrection politique est indissociable de la création d’un foyer national, d’un État à part entière, l’État d’Israël.
-
Par contraste, Arendt insiste fortement, et de manière cette fois très positive, sur le rôle joué par les juges de Jérusalem. Ici, on peut regretter que le film de Margarethe von Trotta n’ait pas poussé plus loin l’analyse. Les juges qui ont été amenés à juger Adolf Eichmann en première instance, et spécialement le président du tribunal de district de Jérusalem, Moshe Landau, ont en effet fortement impressionné Arendt. Selon cette dernière, ces juges se caractérisent par des qualités humaines particulières : ils sont bons, droits, au-dessus de la mêlée. Au contraire de celui de Hausner, leur comportement n’est pas « théâtral » : il se caractérise par sa sobriété. À la mise en scène « politique » du procès, répond ainsi la retenue des juges qui tentent, suivant l’opinion d’Arendt, de s’opposer à l’instrumentalisation du procès de Jérusalem par le procureur et le Premier ministre. Le juge Landau, en particulier, s’efforce d’empêcher que « le procès ne devienne un procès-spectacle, sous l’influence du procureur et de son goût pour la mise en scène » (EJ, 1022).
-
Sous la plume d’Arendt, lorsque la scène judiciaire ne s’apparente pas à un théâtre, elle ressemble à un champ de bataille. Celui-ci ne constitue toutefois pas le cadre d’un affrontement entre l’accusation et la défense, l’État d’Israël et Adolf Eichmann, comme on pourrait s’y attendre, mais plutôt l’occasion d’un combat entre l’accusation et les juges. Tandis que le procureur sert l’État d’Israël, les juges servent la justice. L’opposition que trace Arendt entre l’État et la justice est flagrante, presque caricaturale.
-
Ainsi, il est clair qu’Eichmann à Jérusalem recèle un éloge de la justice (même si, concernant d’autres points plus spécifiques, Arendt se montre davantage critique à l’égard du jugement rendu par le tribunal israélien. La philosophe regrette notamment qu’Eichmann n’ait pas pu être traduit devant une juridiction pénale internationale). J’ai déjà évoqué les lignes directrices de cet éloge : les juges ont fait obstacle à ce que des buts plus hauts, politiques et historiques, ne viennent interférer avec la tâche qui était la leur.
-
Il est toutefois nécessaire d’aller plus loin. Ce n’est en effet pas la justice rendue à Jérusalem, en tant que justice particulière, qui est louée par Arendt : à travers elle, la philosophe tente de mettre en lumière la « grandeur du judiciaire », la dignité de la justice en tant que telle, en tant qu’institution : à l’heure où l’on voudrait faire de chaque individu un simple rouage au sein d’une machinerie complexe et qui le dépasse, il existe une institution dans laquelle les comportements sont évalués sur une base individuelle, une institution dans laquelle une personne ne peut se dédouaner de sa responsabilité en prétextant une tendance historique inéluctable ou une paralysie momentanée de sa faculté de pensée ou de jugement, due à des circonstances politiques exceptionnelles. Le totalitarisme peut bien s’efforcer de transformer chaque individu en un simple rouage d’une machine qui le dépasse, il est possible, une fois l’ennemi totalitaire vaincu, de traiter à nouveau ses serviteurs les plus fidèles, ceux qui revendiquaient une « obéissance de cadavre » – ce qui était le cas d’Eichmann (EJ, 1149) – comme des êtres humains responsables. C’est d’ailleurs cette commune humanité qui permet aux juges professionnels d’endosser la tâche qui est la leur. Ces derniers doivent postuler que la personne qui est traduite devant eux appartient, elle aussi, au genre humain, et que c’est à ce titre qu’elle va être jugée : « c’est une humanité commune que le droit suppose précisément entre nous et ceux que nous accusons, jugeons et condamnons » (EJ, 1261).
-
On le voit, les conséquences du procès Eichmann dépassent largement la question du mal, sur laquelle se focalise le film de Margarethe von Trotta : le problème de la justice est aussi au centre de la réflexion d’Arendt, enclenchée par le procès Eichmann. Étant entendu que les commentateurs d’Arendt, parmi les plus spécialisés, passent souvent à côté d’une telle dimension de sa pensée, on ne peut toutefois pas reprocher à la réalisatrice allemande de n’avoir pas fait de ce problème l’un des thèmes centraux de son long métrage. L’objectif que ce film poursuivait, plus modestement, était de parvenir à rendre vivante l’une des grandes pensées politiques du siècle dernier et de rendre compte de l’intérêt évident et jamais démenti de Hannah Arendt pour l’événement (plutôt que pour les constructions métaphysiques indépendantes des réalités). À ce niveau, on peut dire que la réalisatrice allemande a réussi son pari.



